Femmes célibataires au Maroc et en Algérie: enjeux, défis et pratiques littéraires des femmes
Entretien avec Isabelle Charpentier, auteure de ‘De la difficulté (sexuelle) d’être une femme célibataire au Maghreb – Une étude de témoignages & d’œuvres d’écrivaines algériennes et marocaines‘ 23:4 (2015)
Quels sont les sujets que vous abordez dans votre article ?
L’article montre que les évolutions démographiques et socioculturelles indéniables que connaissent, à des degrés divers, les sociétés algérienne et marocaine contemporaines entraînent des transformations dans l’évolution de la perception des femmes et dans les rapports de genre. On pense ici par exemple à des phénomènes tels l’urbanisation, la scolarisation croissante et prolongée des filles, la progression – relative – de l’activité professionnelle féminine, mais aussi l’augmentation de l’âge moyen des filles au mariage et l’apparition – timide – du célibat féminin. Toutefois, ce dernier phénomène, essentiellement urbain, s’il progresse, demeure moindre, et surtout beaucoup moins toléré socialement que le célibat masculin, en raison notamment des enjeux liés à la nécessaire préservation de la virginité féminine avant l’union matrimoniale. En effet, au-delà des discours prophétiques sur la « modernité », les critères traditionnels d’évaluation de « l’honnêteté » des jeunes femmes, qui se cristallisent autour de cet impératif de la virginité avant l’alliance conjugale, sont actuellement encore très prégnants dans les pays du Maghreb. Ainsi, les Maghrébines célibataires, souvent – très – diplômées et actives, doivent-elles relever différents défis et connaissent des difficultés sociales et affectives diverses : reproches familiaux de ne pas être mariées et mères, quête complexe d’un logement, surveillance et soupçons du voisinage quant à leur « moralité », etc. Malgré ces obstacles, une sexualité féminine hors/avant le mariage, respectueuse ou non de l’intégrité de l’hymen, émerge progressivement à l’écart de la parenté et des aîné-e-s, dans l’illégalité et la clandestinité toujours, dans la honte et la culpabilité parfois. Transgressant les normes juridiques et religieuses, cette sexualité n’est toutefois pas sans risques : celui de perdre sa virginité avant le mariage et, par voie de conséquence, de ne pouvoir ensuite convoler, mais aussi celui, infamant, d’une grossesse hors mariage. Ce risque apparaît particulièrement saillant compte tenu de la situation extrêmement précaire des mères célibataires au Maghreb, notamment des plus pauvres, ces « petites bonnes » souvent mineures, orphelines et/ou d’origine rurale, venues travailler en ville pour des salaires très bas. Un nombre croissant de jeunes femmes sexuellement expérimentées décide alors de recourir à des opérations de réfection d’hymen en prévision d’un prochain mariage, au risque de consolider l’ordre patriarcal.
Mon article traite donc de tous ces enjeux liés au célibat féminin, choisi ou subi, dans le Maghreb contemporain, des liens que cette question entretient avec celle de la virginité et, au-delà, de la sexualité des femmes dans des sociétés où l’islam est religion d’Etat, à travers un prisme original qui est celui de la littérature.
Comment les écrivaines algériennes et marocaines d’expression française traitent-elles de ce sujet encore tabou dans leurs récits, dont on sait que nombre d’entre eux sont autofictionnels – l’autobiographie directe, en première personne, était encore très difficile pour une auteure maghrébine ? Comment l’évoquent-elles lorsqu’on les interroge sur cette question lors d’entretiens sociologiques ?
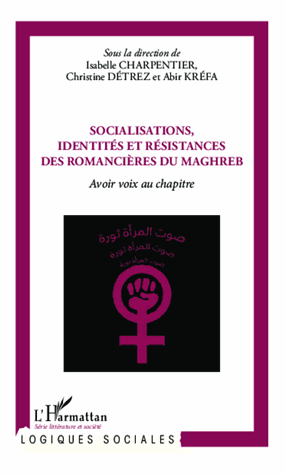
Quels sont les auteurs, les concepts et les théories qui informent votre travail ?
Je m’inscris clairement dans une perspective transdisciplinaire. L’article prend appui sur les travaux de différent-e-s auteur-e-s spécialistes de sociologie du genre, de la famille et de la sexualité dans des sociétés patriarcales arabo-musulmanes – le concept de domination masculine (Pierre Bourdieu) est donc mobilisé. M’inscrivant aussi dans une perspective foucaldienne, où les différents pouvoirs exercés sur les corps sont symbiotiquement liés aux pratiques de résistance qu’ils contribuent à créer malgré eux, je cherche également à analyser différents discours écrits et oraux d’écrivaines qui remettent publiquement en cause les normativités patriarcales de la sexualité. Je m’appuie enfin sur les travaux de spécialistes de sociologie de la littérature, spécifiquement de celle produite par des Maghrébines.
Comment vous situez-vous par rapport aux autres études sur le sujet ?
Les dernières décennies ont vu émerger des travaux sociologiques sur les pratiques littéraires des femmes, qui étudient les conditions sociales de leur venue à l’écriture et de leur publication, les difficultés spécifiques qu’elles peuvent rencontrer dans l’accès à la visibilité et à la reconnaissance esthétiques, leurs trajectoires, leur place dans différents champs littéraires européens – encore largement dominés par les hommes –, les thématiques (souvent de l’ordre de la sphère privée et de l’intime) qu’elles peuvent privilégier dans leurs œuvres – je pense ici notamment aux travaux de Christine Planté, de Monique de Saint-Martin, de Delphine Naudier, de Vanessa Gémis, ou encore de Jennifer Milligan. Mais aucune étude sociologique ne portait spécifiquement sur les écrivaines maghrébines contemporaines, pourtant de plus en plus nombreuses et suscitant un intérêt croissant de la part des critiques littéraires académiques et journalistiques.
Sans prétendre que les productions littéraires permettent d’analyser, à l’instar de documents ethnographiques, la réalité sociale des comportements sexuels, j’ai cherché, pour ma part, à objectiver sociologiquement ces matériaux, et à rendre compte des conditions sociales de production de textes écrits par des Maghrébines et des représentations sociales sur les rapports sociaux de sexe qu’ils s’efforcent de reconstituer, par le biais d’un travail littéraire revendiqué comme tel par les auteures. Les écrivaines du Maghreb sont aussi des témoins, et les descriptions littéraires qu’elles effectuent à partir du réel donnent au sociologue des matériaux empiriques précieux pour penser la façon dont la sexualité se vit et s’exprime au sein des pays arabo-musulmans. C’est d’autant plus vrai qu’il n’existe quasiment pas de travaux sociologiques menés au Maghreb sur les pratiques sexuelles. Cette littérature éminemment politique rend visibles et questionne des dimensions qui restent encore profondément taboues en Afrique du Nord. En outre, l’objectivation sociologique de telles œuvres permet de travailler des questions plus vastes relatives aux fonctions de la création littéraire et à son rôle dans le combat contre les dominations, l’écriture littéraire s’enracinant toujours dans le social (culturel, économique, religieux, etc.).
Quelle approche méthodologique avez-vous utilisé ?
Je me suis d’abord appuyée sur les matériaux recueillis à la faveur de la vaste enquête internationale et pluridisciplinaire « Écrire sous/sans voile – Femmes, Maghreb et écriture » (elle réunissait des sociologues français-e-s et des littéraires issu-e-s des trois pays du Maghreb), initialement collective, placée de 2006 à 2008 sous la direction de Christine Détrez (Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon) – Ministère des Affaires Étrangères – Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) France Maghreb – Maison des Sciences de l’Homme –, et qui portait au départ sur le thème des conditions d’entrée en écriture et de publication des femmes auteures originaires de la région du Maghreb. Sur cette base, mais aussi sur d’autres investigations menées de 2009 à 2012 en propre, j’ai réalisé une analyse interne d’un nombre important d’œuvres littéraires d’écrivaines algériennes et marocaines contemporaines, notamment francophones, ainsi que de témoignages recueillis par entretiens auprès de certaines d’entre elles. Le dispositif méthodologique est donc original de ce point de vue, puisqu’il mêle une analyse sociologique des conditions de production des œuvres, et une étude interne de celles-ci. Bien sûr, il ne s’agissait nullement d’universaliser les expériences évoquées en entretiens et/ou mises en récit, de façon plus ou moins romancée, par quelques intellectuelles culturellement et socialement favorisées, mais bien plutôt de considérer ces « traces » littéraires et testimoniales comme un matériau – l’un des seuls disponibles actuellement sur ces thèmes du célibat, de la virginité et de la sexualité des femmes au Maghreb – à objectiver sociologiquement.
Comment cet article se situe-t-il par rapport à vos autres activités de recherche ?
Depuis ma thèse de Doctorat de Science politique qui portait sur les conditions de production et les réceptions de l’œuvre de l’écrivaine française Annie Ernaux (Une Intellectuelle déplacée. Enjeux et usages sociaux et politiques de l’œuvre d’Annie Ernaux (1974-1998), Thèse pour le Doctorat de Science politique (dir. B. Pudal), Amiens, Université de Picardie – Jules Verne, 1999), je travaille sur la sociologie de la littérature, en lien avec la sociologie du genre.
Plus spécifiquement concernant les productions littéraires des Maghrébines, l’enquête collective que je viens d’évoquer a notamment abouti à la co-direction, avec les sociologues Christine Détrez et Abir Kréfa, d’un ouvrage collectif, intitulé Socialisations, identités et résistances des romancières du Maghreb. Avoir voix au chapitre (Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », série « Littératures & société », 2013).
J’ai ensuite investi personnellement le thème des représentations de la virginité, des interdits sexuels et des rapports de genre au Maghreb dans les œuvres littéraires et les témoignages d’écrivaines (franco-)maghrébines. En effet, depuis une vingtaine d’années, nombreuses sont les auteures (franco-)algériennes et (franco-)marocaines – parfois encore peu (re)connues en France – à briser le silence sur le tabou rémanent pesant sur la virginité des filles dans leurs sociétés patriarcales respectives. Á l’heure où les demandes de certificats de virginité et de réfection d’hymen en prévision d’un prochain mariage semblent se multiplier en Algérie et au Maroc, et en l’absence d’études sociologiques systématiques menées dans les deux pays sur les pratiques sexuelles concrètes, les écrivaines contribuent ainsi dans leurs textes littéraires – introuvables en France pour certains – à mettre en lumière les formes souvent violentes, matérielles ou symboliques, de la socialisation et des dominations qui ont contraint ou contraignent encore la sexualité des femmes dans des sociétés androcentrées. Évoquant frontalement cet interdit – et ses frontières mouvantes –, les représentations stéréotypées du féminin et du masculin qui l’entourent, les enjeux et implications qui le sous-tendent, dans des récits souvent autofictionnels, les auteures reconnaissant l’existence d’une sexualité des filles hors mariage et la « visibilisent » littérairement. C’est ainsi que j’ai été amenée à travailler sur la question du célibat féminin. Dans deux pays où l’islam est religion d’État, les écrivaines participent plus largement à déconstruire et à remettre en question les rapports sociaux de pouvoir au fondement des relations de genre, projetant ainsi le débat au cœur des espaces publics algérien et marocain contemporains, par ailleurs secoués par des mouvements de contestation sociale et politique divers, dans la lignée de ce qu’on a appelé « les printemps arabes ». Cette enquête a donné lieu à la soutenance d’une Habilitation à diriger des recherches en Sociologie et en Études politiques à l’EHESS en janvier 2013, à la publication d’un ouvrage en nom propre (Le Rouge aux joues – Virginité, interdits sexuels et rapports de genre au Maghreb – Une étude d’œuvres et de témoignages d’écrivaines (franco-)algériennes et (franco-)marocaines, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, coll. « Littératures postcoloniales – Long-courriers », sous-coll. « Essais », 336 pp.), à la publication de quatre articles dans des revues internationales et nationales (Modern & Contemporary France, mais aussi International Journal of Francophone Studies, Autrepart et Awal), ainsi qu’à sept chapitres d’ouvrages collectifs.

Je commence actuellement à investir deux derniers objets, sur la base notamment du matériau qualitatif recueilli lors de l’enquête initialement collective portant sur les conditions d’entrée en écriture et de publication des écrivaines (franco)maghrébines d’expression française, en reprenant et prolongeant les réflexions que j’avais amorcées antérieurement autour de la sociologie de la production des biens symboliques, de leurs réceptions et de leurs usages, mais aussi en sociologie du genre et/ou de la sexualité.
Le premier objet porte sur les représentations et les usages du mythe dit de « l’enfant endormi » dans la littérature et le cinéma francophones produits par des artistes maghrébines. Ce mythe du « ragued » – on trouve aussi les désignations de « rajel » ou d’« oumergoud » –, pose que les femmes – et parfois les deux parents – ont la capacité « d’endormir » pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, un fœtus (viable) dans le ventre maternel pour retarder sa naissance à un moment jugé « opportun ». Né dans l’ère préislamique, ce mythe rémanent aux soubassements animistes, d’origine kabyle, semble historiquement lié à des pratiques de « sorcellerie blanche ». Il survit largement à l’apparition de l’islam, alors que le Coran interdit pourtant le recours à la magie et à la sorcellerie. Apparemment paradoxale dans des sociétés patriarcales où le droit objectif comme le droit musulman interdisent les relations sexuelles et, a fortiori, les grossesses en dehors du cadre matrimonial, les justifications de cette croyance populaire, à l’instar des fonctions qu’elle remplit et des usages sociaux qui en sont faits, apparaissent multiples. Du point de vue masculin, le ragued est historiquement considéré comme garantissant une sorte de « ceinture de chasteté » pour les épouses : les hommes en partance pour la guerre « endormiraient » ainsi les fœtus dans le ventre de leurs femmes, pour maintenir ces dernières dans un « état maternel », s’assurant ainsi… de leur fidélité. Plus pragmatiquement, cette tactique magique vise surtout à « invisibiliser » la transgression sexuelle féminine, en permettant au clan, menacé dans son honneur, de dissimuler des grossesses « honteuses », « infamantes » puisque survenues hors mariage : cette croyance autorise en effet une épouse éloignée de son mari depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui donne naissance à un enfant, à éluder toute accusation d’adultère, tout en voyant son bébé accueilli avec joie par le clan familial. Lors d’un veuvage, le ragued permet aussi d’assurer l’héritage. La puissance du mythe est telle que ses conséquences sont intégrées dans les législations maghrébines. Dans ces sociétés patriarcales soumises au droit musulman, de nombreux exégètes et législateurs islamiques ont pu soutenir au fil des siècles que la durée de la gestation humaine pouvait varier de six mois à… dix ans. Selon un hadîth rapporté par Aïcha, l’épouse du Prophète, l’enfant ne peut rester dans le ventre de sa mère plus de deux ans ; le Coran évoque, quant à lui, 30 mois pour la durée possible d’une grossesse, tandis que des théologiens et des juristes musulmans, comme par exemple l’imam Malik ibn Anas (711-795), fondateur de l’école malékite, situent la durée de la gestation potentielle entre trois et dix ans. Dès lors, quand une femme accouche plusieurs mois, voire plusieurs années après un divorce, le décès ou l’absence de son mari, ce dernier est réputé légalement être le père du nouveau-né. Cette législation islamique, en vigueur depuis plus de 14 siècles, continue de trouver par exemple un écho dans la Moudawana, le nouveau Code de la famille marocain adopté en 2004 : les articles 153 et 154 stipulent ainsi que la durée de la gestation peut aller de six mois après le mariage à un an après le divorce ou le veuvage. En conséquence, aujourd’hui encore, si une femme, divorcée ou veuve, donne naissance à un enfant dans un intervalle d’un an, la paternité de l’époux est supposée. Et si ce dernier la conteste, c’est à lui d’apporter « les preuves irréfutables de sa non paternité ». Ce mythe – et la transgression d’un interdit majeur dans les sociétés musulmanes qu’il révèle, celui d’une sexualité féminine en dehors du cadre du mariage, adultérine qui plus est –, constitue la thématique centrale de plusieurs romans et films produits par des écrivaines et cinéastes maghrébines d’expression française, dont les intrigues sont toutes situées dans le Maghreb contemporain : ainsi, pour le Maroc, du roman de Noufissa Sbaï, L’Enfant endormi (1988), ou du film éponyme de la cinéaste Yasmine Kassari, sorti en 2005 ; en Algérie, la journaliste et romancière Hawa Djabali s’y réfère également, de même que la femme politique et militante féministe Khalida Toumi-Messaoudi, dans son autobiographie Une Algérienne debout, parue chez Flammarion en 1992.
Étudiant les représentations de la sexualité que ce mythe toujours vivace du ragued véhicule au travers de l’analyse de sa mise en scène dans la littérature et dans le cinéma féminins maghrébins francophones, mais aussi des ressorts de sa légitimation officielle dans le droit musulman contemporain, ma recherche tend à éclairer une forme paradoxale de politisation de la sexualité que révèle cette croyance populaire multiséculaire défiant la raison et la science, a priori si dissonante dans des sociétés androcentrées. Mon travail d’enquête interroge notamment les effets des processus de socialisation sur les pratiques liées au corps et à la sexualité et, au-delà, sur la formation et la perpétuation de la division genrée des rôles sociaux dans les pays maghrébins. Je rédige actuellement un article sur ce thème.
Toujours sur la base d’une exploitation du matériau qualitatif recueilli lors de l’enquête collective, je construis enfin un dernier objet de recherche, à la croisée de la sociologie de la littérature et des pratiques et usages de la lecture. Il porte sur le rôle des lectures de jeunesse dans la naissance de la « vocation » littéraire des écrivaines (franco-)maghrébines. En effet, au cours des entretiens réalisés entre 2006 et 2012, ces dernières ont été amenées à évoquer leur enfance, leur adolescence et l’influence souvent présentée comme essentielle de ces premières périodes de formation intellectuelle sur leur trajectoire future d’écrivaines, au moins « d’aspiration ». Bien sûr, ces propos des auteures du Maghreb ne leur sont pas spécifiques : le lien communément établi par les intéressé-e-s entre apprentissage de la lecture, découverte de la littérature (souvent en contexte scolaire) et naissance d’une « vocation » littéraire constitue une sorte de passage obligé, presque un topos, du récit de jeunesse des écrivain-e-s. L’illusion rétrospective peut sans doute l’expliquer, la tentation étant forte – tant pour l’auteur-e que pour ses lecteurs – de voir se dessiner, derrière la figure de l’enfant/de l’adolescent-e entouré-e de livres, passionné-e de lecture, celle du/de la futur-e écrivain-e. Pourtant, aussi attendu soit-il et quelle que soit la part de reconstruction en jeu, ce retour fréquemment accompli par les écrivaines (franco-)maghrébines sur leurs lectures de jeunesse apparaît, sous plusieurs aspects, intéressant à analyser. La recherche que j’ai commencée tend à étudier les contextes, les types, l’intensité et les niveaux variables de l’activité de lecture préalable à l’entrée en écriture, les émotions que la lecture a suscitées (plaisir du jeu avec la langue, les mots, rapport exclusif, voire « addictif » à cette pratique culturelle souvent distinctive par rapport au milieu social d’origine, découverte d’univers inconnus, de nouveaux rapports possibles au monde, évasion, voire catharsis, consolation en cas de trajectoires biographiques heurtées et/ou marquées par des traumatismes…), et que l’écriture a parfois pu ensuite chercher à reproduire. De fait, les pratiques et influences lectorales revendiquées (ou pas) par les écrivaines (franco-)maghrébines apparaissent multiples et disparates. Grâce aux éléments biographiques contenus dans les entretiens, je constitue actuellement une base prosopographique qui devrait permettre de les analyser sociologiquement.
